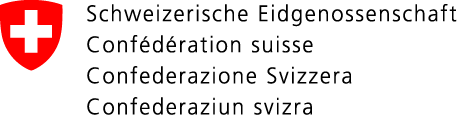3 Coûts du réseau (comptabilité analytique, chapitre 3)
3.1 Généralités (comptabilité analytique, formulaire 3.1)
3.1.1 Aperçu
Tous les gestionnaires de réseau doivent compléter le formulaire « Généralités », qui présente les bases du calcul des différences de couverture de l’année tarifaire 2024 (cf. formulaire 3.2 de la comptabilité analytique, ci-après point 3.2). Veuillez n’utiliser pour ce formulaire que des valeurs effectives et non des valeurs prévisionnelles (valeurs effectives du dernier exercice clôturé).
Les coûts de réseaux amont doivent être présentés dans ce formulaire. Dans la version complète, il faut en outre mentionner les coûts des pertes actives et de l’énergie réactive.
3.1.2 Pertes actives
Les pertes actives sont la différence entre l’énergie électrique mise à disposition dans le réseau et celle fournie aux consommateurs finaux et aux clients revendeurs (pertes de transformation et de transport). Ces pertes figurent dans les coûts d’exploitation (cf. point 3.2.9 ss). Les pertes actives doivent être évaluées pour chaque niveau de réseau. Elles sont autant que possible déterminées par mesure différentielle. Lorsque, pour certains niveaux de réseau, les mesures font défaut ou que le nombre de points de mesure est insuffisant, les pertes sont calculées sur la base d’un bilan énergétique global et réparties entre les différents niveaux à l’aide d’une clé de répartition ou selon un calcul modélisé (cf. document de l’AES DC-CH, édition 2020, point 8.3).

À noter : les coûts effectifs des pertes actives doivent reposer sur des coûts réels, ventilés si nécessaire. Il n’est pas admissible de présenter des coûts des pertes actives reposant sur des valeurs prévisionnelles ou des estimations dans le cadre du calcul des différences de couverture.
3.1.3 Énergie réactive
Le gestionnaire de réseau assure la compensation de la puissance réactive dans son réseau de distribution. Le gestionnaire de réseau pourvoit lui-même ou par des contrats avec des tiers aux possibilités de compensation nécessaires dans le réseau de distribution et dans les unités de production (cf. document de la branche publié par l’AES Distribution Code Suisse (DC-CH)).
Une facturation directe conforme au principe de causalité est possible, par exemple si cos(φ) < 0.90, pour la compensation de la puissance réactive. S’il est fait usage de cette possibilité de facturation directe, il faut s’assurer qu’aucune facturation double ne survienne dans la rémunération de l’utilisation du réseau et la facturation directe.
3.1.4 Situations dites de « pancaking » à éviter
Lorsque des réseaux appartenant à des propriétaires différents sont connectés les uns derrière les autres à l’intérieur d’un niveau de réseau ou sont mélangés sur le même niveau de réseau, il se produit une situation dite de « pancaking », c’est-à-dire que les consommateurs finaux courent le risque de se voir facturer plusieurs fois les coûts d’un niveau de réseau : les coûts du niveau de réseau du gestionnaire de réseau en aval s’ajoutent aux coûts de réseau facturés par son fournisseur en amont. Le revendeur peut à son tour répercuter ces coûts - plus élevés - sur ses clients.
Dans son document de la branche « Modèle d’utilisation des réseaux suisses de distribution » (MURD-CH), l’Association des entreprises électriques suisses (AES) a fixé des règles en la matière au sens de l’art. 17 OApEl. L’ElCom s’est elle aussi déjà exprimée sur ce thème (cf. décision de l’ElCom du 20 octobre 2011, 921-10-007).
L’ElCom observe ce genre de constellations d’un œil critique : les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir par des mesures appropriées que le consommateur final ne fasse pas les frais d’une facturation multiple en raison du simple fait que plusieurs acteurs sont responsables de l’exploitation du réseau à un même niveau de réseau.
3.2 Différences de couverture du réseau (comptabilité analytique, formulaire 3.2)
3.2.1 Bases légales
Suite à l’introduction de l’art. 18a OApEl, entré en vigueur le 1er janvier 2023, l’ElCom a publié la nouvelle directive 3/2024 des 4 mars 2024 et 4 février 2025 sur les différences de couverture (DC) du réseau et de l’énergie des années précédentes. Les nouvelles dispositions relatives aux DC s’appliquent pour la première fois aux DC de l’exercice suivant l’entrée en vigueur (art. 31m OApEl). L’article 18a OApEl s’applique donc pour la première fois aux DC de l’exercice 2023/2024 (année hydrologique) ou 2024 (année civile). L’art. 18a deviendra l’art. 18b le 1er janvier 2026.
Si le montant total de la rémunération pour l’utilisation du réseau perçue par le gestionnaire du réseau pendant une année tarifaire ne concorde pas avec les coûts de réseau imputables (différence de couverture), le gestionnaire de réseau compense cet écart dans les trois années tarifaires suivantes. Il peut renoncer à compenser un découvert de couverture (art. 18a, al. 1, OApEl).
Dans des cas justifiés, l’ElCom peut prolonger le délai imparti pour compenser une différence de couverture (art. 18a, al. 2, OApEl).
Pour les différences de couverture à partir de l’exercice 2024, il convient de respecter la directive 3/2024 (y c. les formulaires de différences de couverture). Pour le traitement des différences de couverture jusqu’à la fin de l’exercice 2023 inclus, il faut continuer de se reporter à la directive 2/2019 (y c. aux formulaires de différences de couverture).
On trouvera des informations supplémentaires relatives aux différences de couverture dans la décision du 12 mars 2012 sur les tarifs 2012 pour l’utilisation du niveau de réseau 1 ou dans les décisions concernant les différences de couverture 2011 et 2012 du niveau de réseau 1 des 12 janvier 2021 ou 9 février 2021 (disponibles sous ElCom (admin.ch) > Documentation > Décisions > 2012 ou 2021).
3.2.2 Généralités concernant le formulaire
Le formulaire « Différences de couverture du réseau » doit être complété par tous les gestionnaires de réseau.
Les différences de couverture résultent de l’écart temporel entre le calcul des tarifs, les recettes tarifaires et les coûts réels d’un exercice. Lors de l’analyse des différences de couverture des années précédentes, les écarts entre les coûts imputables et les revenus réalisés pendant une période de calcul sont compensés.
Il est notamment tenu compte des différences qui
- résultent d’écarts entre les quantités de vente prévisionnelles et les quantités effectives,
- résultent d’écarts entre les coûts prévisionnels et les coûts réels,
- ont été constatées lors d’un contrôle réalisé par l’ElCom ou
- résultent du fait que des éléments spéciaux ayant une influence sur les coûts n’ont pas été saisis en totalité lors d’une période de calcul, afin de stabiliser les tarifs.
Les formulaires de saisie des coûts servant de base au calcul des différences de couverture de l’année de base 2024 (formulaire 3.2 du fichier de comptabilité analytique) et justifiant le calcul des tarifs 2026 (formulaire 3.3 du fichier de comptabilité analytique) ont la même structure. Les numéros des positions de coûts suivent ceux du Schéma de calcul des coûts pour gestionnaires de réseau de distribution suisses (SCCD-CH) publié par l’AES.
Dans le formulaire 3.2 Différence de couverture du réseau (suivant) on calcule les excédents ou les découverts de couverture du dernier exercice clôturé. Pour calculer les différences de couverture du réseau propre et du réseau en amont (y c. services-système et réserve d’électricité) de l’année précédente, il faut remplir le formulaire 3.2 Différence de couverture du réseau de la comptabilité analytique sur la base des coûts effectifs (y c. amortissements et intérêts théoriques) et des autres produits et revenus de l’année précédente (coûts et revenus effectifs). Ces remarques valent aussi pour les flux d’énergie et les valeurs de puissance utilisés lors de la cascade comme base de calcul des différences de couverture par niveau de réseau. Dans le formulaire 3.2 Différence de couverture du réseau (suivant), la différence de couverture est calculée automatiquement. Les éventuelles adaptations des années tarifaires précédentes décidées par l'ElCom (ou par des instances supérieures) doivent être enregistrées à la position 2. À la position 3, on indique les excédents ou les découverts de couverture des années précédentes que l’on ne peut affecter ni à la position 1 ni à la position 2 (cf. point 3.2.25).
3.2.3 Moment du calcul des différences de couverture
Le calcul des différences de couverture doit être effectué lors de chaque exercice comptable. Dans le cadre du calcul des coûts 2026, on calcule ainsi les différences de couverture du dernier exercice clôturé (2024).
Le montant des différences de couverture se calcule en comparant les revenus effectifs du dernier exercice comptable clôturé (2024) et les coûts effectifs du même exercice (2024).
La figure suivante illustre les relations entre l’année tarifaire (AT), l’année comptable (AC) et le calcul des différences de couverture (DC) :

À la fin de chaque exercice comptable (exercice 0 dans notre exemple), il faut calculer les différences de couverture du réseau de l’exercice à boucler (calcul rétroactif des coûts de l’AT 0). Les éventuelles différences de couverture résultant des décisions de l’ElCom ou des arrêts des tribunaux ainsi que les autres différences de couverture doivent également être prises en compte. Ces différences de couverture sont généralement réparties sur trois périodes consécutives de calcul des tarifs (AT 2, AT 3 et AT 4 dans l’exemple ci-dessus).
À la fin de l’exercice comptable suivant (exercice 1), on calcule la nouvelle différence de couverture pour l’année tarifaire écoulée (DC de l’AT 1). Si des différences subsistent en raison de décisions de l’ElCom ou d’arrêts des tribunaux, elles doivent également être prises en compte. La première partie de cette différence de couverture à réduire est prise en compte dans le calcul tarifaire de l’AT 3.
3.2.4 Calcul des différences de couverture par niveau de réseau
Les différences de couverture du réseau doivent être calculées et présentées par niveau de réseau.
Les coûts d’exploitation du réseau ne peuvent souvent pas être imputés à un seul niveau de réseau. Pour de tels cas, le Schéma de calcul des coûts pour les gestionnaires de réseau de distribution CH (SCCD-CH), publié par l’AES, prévoit deux variantes de solution :
- Les coûts d’exploitation du réseau qui ne sont pas directement attribuables à un niveau de réseau sont attribués au niveau de réseau le plus élevé du gestionnaire de réseau de distribution. Les coûts de chacun des niveaux de réseau présentant des ventes réseau sont reportés sur la base du modèle de la cascade.
- Les coûts d’exploitation du réseau sont répartis entre les différents niveaux de réseau à l’aide d’une clé de répartition.
3.2.5 Rémunération des différences de couverture
Selon les directives 3/2024 et 2/2019 de l’ElCom (y c. annexes), l’année de référence déterminante pour le WACC applicable n’est pas l’année tarifaire durant laquelle la différence de couverture est survenue (t), mais l’année durant laquelle cette différence peut être comptabilisée pour la première fois (t+2). Le Tribunal fédéral a confirmé cette méthode de définition des intérêts (ATF 2C_1076/2014 du 4 juin 2015, consid. 4).
Le solde de différence de couverture à la fin de l’exercice 2023 doit être rémunéré avec le WACC du réseau de l’année tarifaire t+2[1]. Il doit donc être intégralement résorbé (c’est-à-dire intérêts compris) au plus tard à la fin de l’exercice 2027.
Pour la DC du réseau jusqu’en 2023, la rémunération se calcule sur la base du taux de WACC du réseau de l’année tarifaire en cours (t+2). Par contre, à partir de la DC 2024 (t), la rémunération se calcule sur la base du taux de rendement des fonds étrangers de l’année tarifaire en cours (t+2) (art.18a, al. 3, OApEl).
Ainsi, les excédents de couverture du réseau doivent être rémunérés au minimum selon le taux de l’année du calcul des tarifs en cours. En l’occurrence, en cas de solde d’excédents de couverture jusqu’en 2023, ce dernier doit être rémunéré au minimum au taux de WACC du réseau applicable à l’année tarifaire 2026, soit 3,43 %. Par contre, en cas d’excédent de couverture 2024, celui-ci doit être rémunéré au taux de rendement des fonds étrangers applicable à l’année tarifaire 2026, soit 2,00% (art. 18a, al. 3, let. b, OApEl).
Le taux applicable aux découverts de couverture du réseau est au maximum le taux de l’année tarifaire du calcul des tarifs en cours. En l’occurrence, en cas de solde de découvert de couverture jusqu’en 2023, ce dernier doit être rémunéré au maximum au taux de WACC du réseau applicable à l’année tarifaire 2026, soit 3,43%. Par contre, en cas de découvert de couverture 2024, celui-ci doit être rémunéré au taux de rendement des fonds étrangers applicable à l’année tarifaire 2026, soit 2,00%. Pour les découverts de couverture, vous pouvez, en tout temps, appliquer un taux inférieur, voire renoncer complètement à une rémunération (art. 18, al. 3a, OApEl).
[1] L’année « t » désigne l’exercice pour lequel les différences de couverture sont calculées.
3.2.6 Réduction des différences de couverture
On considère que la réduction des différences de couverture est efficace (art. 14, al. 3, let. a, et art. 15, al. 1, LApEl) lorsqu’elle permet d’éviter des coûts (d’intérêt) inutiles à la charge des consommateurs finaux et que la réduction a lieu rapidement. Le montant de la différence de couverture à compenser doit être entièrement résorbé, y compris les intérêts correspondants, au plus tard dans les trois années tarifaires suivantes (art. 18a, al. 1, OApEl).
La réduction d’une différence de couverture sur plus de trois ans n’est autorisée qu’avec l’accord de l’ElCom (art. 18a, al. 2, OApEl). Si un gestionnaire de réseau souhaite réduire une différence de couverture sur une période prolongée, il doit déposer une demande motivée auprès de l’ElCom (art. 18a, al. 2, OApEl).
Les découverts de couverture qui n’ont pas été réduits au bout de trois ans ou à l’expiration de la durée de réduction prolongée doivent être supprimés sans incidence sur les tarifs.
La compensation d’une différence de couverture réalisée lors de l’exercice t peut se faire de différentes manières :
- Prise en compte dans les tarifs à partir de l’année t+2 : le montant de réduction prévu dans le cadre du calcul des tarifs est contraignant et doit être repris à l’identique lors du calcul rétroactif.
- Réduction sans incidence sur les tarifs : seuls les découverts de couverture peuvent être réduits sans incidence sur les tarifs. Les excédents de couverture doivent impérativement être compensés.
Une procédure en cours auprès de l’ElCom ou d’un tribunal, qui pourrait avoir des répercussions sur les différences de couverture, ne constitue pas une raison suffisante de renoncer à la réduction des différences de couverture déclarées conformément à la directive ou de laisser s’accumuler les intérêts.
Pour la DC du réseau jusqu’en 2023, la règle de compensation du solde est toujours valable. Le solde à la fin de l’exercice 2023 doit être résorbé dans un délai maximum de trois ans. Il doit donc être intégralement résorbé (c’est-à-dire intérêts compris) au plus tard à la fin de l’exercice 2027, sous réserve d’une autorisation de l’ElCom pour une prolongation de ce délai. Dès 2024, on ne compense plus le solde des DC de plusieurs exercices, mais chaque DC annuelle est traitée séparément (cf. art. 18a, OApEl).
Dans le formulaire 3.2 Différence de couverture du réseau (suivant), la réduction du solde de différence de couverture 2023 et celle de la différence de couverture 2024 sont présentées séparément.
3.2.7 Découverts de couverture
Il n’est pas permis d’utiliser les différences de couverture comme instrument de financement ou pour alimenter des réserves. Il est donc illicite, notamment, de constituer une réserve de découverts de couverture.
L’ElCom surveille de près si les gestionnaires de réseau tiennent compte de découverts de couverture lors de la tarification, c’est-à-dire s’ils prévoient des découverts de couverture dès l’établissement de leurs calculs. Aux yeux de l’ElCom, il est illicite de constituer sciemment des différences de couverture, en particulier des découverts de couverture, dès l’étape de la planification. Ainsi, les gestionnaires de réseau sont tenus de calculer soigneusement les coûts et les tarifs qui en découlent, de manière à établir un bilan coûts-revenus équilibré en fin d’année tarifaire.
Dans les cas où des découverts de couverture résultent de décisions (politiques) qui visent à ne pas tenir compte de tous les coûts dans les tarifs et que ces découverts ne sont délibérément pas réduits au moyen de la tarification, il n’est pas autorisé d’accumuler ces différences de couverture. Le montant correspondant doit être régulièrement éliminé des découverts de couverture sans incidence sur les tarifs. On peut notamment procéder par une réduction en enregistrant une valeur positive dans la rubrique « Autres différences de couverture ».
3.2.8 Présentation des coûts du capital (position 100)
3.2.8.1 Bases légales et principes généraux
En vertu de l’art. 15, al. 3, LApEl, les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d’achat ou de construction des installations existantes. Dans ce contexte, le montant des immobilisations régulatoires imputables et, partant, l’évaluation sont essentiels (cf. points 2.2 ss. et 2.3 ss.). Les éléments déterminants sont, d’une part, les amortissements théoriques et, d’autre part, les intérêts théoriques sur les valeurs résiduelles du patrimoine nécessaire à l’exploitation du réseau.
3.2.8.2 Présentation des amortissements théoriques (position 100.1)
Concernant les amortissements, cf. point 2.2.15.
3.2.8.3 Présentation des intérêts théoriques pour les réseaux (position 100.2)
Les gestionnaires de réseau ont droit à des intérêts théoriques sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation du réseau. Le taux d’intérêt théorique déterminant est le taux du coût moyen pondéré du capital engagé (WACC pour « weighted average cost of capital). Le WACC décrit le rendement moyen que les bailleurs de fonds peuvent attendre du capital qu’ils investissent, compte tenu du risque encouru (cf. ANDRE SPIELMANN dans : Kommentar zum Energierecht, Brigitta Kratz / Michael Merker / Renato Tami / Stefan Rechsteiner / Kathrin Föhse [éd.], tome I, Berne 2016, art. 15, LApEl, ch. marg. 58). Le WACC pour le réseau est fixé chaque année par le DETEC sur la base des calculs de l’OFEN, après consultation de l’ElCom.
En votre qualité de gestionnaire de réseau, pour calculer la rémunération de votre capital nécessaire à l’exploitation, vous pouvez appliquer un taux inférieur au WACC valable pour l’année tarifaire concernée. Tel peut être par exemple le cas si vous renoncez explicitement au bénéfice réglementaire maximum autorisé. En revanche, il n’est en aucun cas admissible d’appliquer un taux supérieur au WACC fixé par la loi.
Les intérêts rémunérant les différences de couverture sont régis par les principes ci-dessus (cf. point 3.2.5).
3.2.8.4 Présentation des intérêts théoriques pour les installations en construction (position 100.3)
Il convient d’observer ici les explications du point 3.2.8.3 Présentation des intérêts théoriques des réseaux (position 100.2) et du point 2.2.6 Installations en construction.
3.2.9 Présentation des coûts d’exploitation (position 200)
3.2.9.1 Bases légales et principes généraux
Sont réputés coûts d’exploitation les coûts des prestations directement liées à l’exploitation des réseaux. En font notamment partie les coûts relatifs aux services-système et à l’entretien des réseaux
(anc. art. 15, al. 2, LApEl). Sont aussi considérées comme coûts d’exploitation imputables les indemnités accordées pour l’octroi de droits et de servitudes en lien avec l’exploitation du réseau (art. 15, al. 2, let. c, LApEl).
Les coûts d’exploitation ne sont imputables que s’ils sont nécessaires à l’exploitation d’un réseau sûr, performant et efficace (art. 15, al. 1, LApEl). Pour vérifier que les coûts revendiqués correspondent aux « coûts d’un réseau efficace », l’ElCom peut procéder à des comparaisons de l’efficacité (art. 19, al. 1, OApEl).
Les coûts d’exploitation reposent sur les valeurs effectives des coûts selon vos comptes annuels, c’est-à-dire selon votre comptabilité financière (cf. 1.1.6.2 ci-dessus).
Deux questions sont essentielles au moment de déterminer les coûts d’exploitation :
- Tous les coûts d’exploitation sont-ils effectivement imputables selon les dispositions de la régulation ?
- Tous les coûts d’exploitation sont-ils correctement attribués au réseau ou à l’énergie ?
On peut approximativement répartir les gestionnaires de réseau en deux groupes : les « entreprises fournissant exclusivement de l’électricité » et les « entreprises multifluides », qui poursuivent encore d’autres activités. Pour ces dernières en particulier, la question de la répartition correcte des coûts entre les différents secteurs d’activité se pose toujours. Si cette répartition n’est pas correcte, il en résulte des subventionnements croisés volontaires ou involontaires, mais assurément non autorisés entre l’exploitation du réseau et les autres secteurs d’activité (p. ex. l’énergie ou la communication).
3.2.9.2 Imputation des coûts et répartition
Les principes suivants régissent l’attribution des coûts d’exploitation : les coûts sont imputés directement lorsque cela est possible. Si tel n’est pas le cas, il est permis de les répartir. Conformément à l’art. 7, al. 5, OApEl, les coûts doivent être imputés dans le respect du principe de causalité à tous les secteurs générant des coûts. À cet effet, les clés de répartition doivent être pertinentes, vérifiables, constantes dans leur conception comme dans leur application et consignées par écrit.
Une clé de répartition est pertinente si elle conduit à une répartition des coûts respectueuse du principe de causalité et si d’autres clés envisageables ne présentent pas de meilleure solution en termes de respect du principe de causalité.
Ainsi, il est pertinent de répartir les coûts de personnel en fonction des effectifs de personnel des différents secteurs d’activité. Il en va de même de la répartition des coûts informatiques en fonction du nombre de postes de travail informatiques des différents secteurs d’activité. Une répartition en fonction de la charge de travail, c’est-à-dire une clé basée sur les proportions d’heures fournies et rapportées serait aussi pertinente.
Par contre, une répartition des coûts en fonction du chiffre d’affaires ou sur la base du total des coûts n’est pas pertinente. Dans le domaine de la régulation, le chiffre d’affaires dérive des coûts régulatoires, de sorte qu’une telle clé se référerait à elle-même : elle ne refléterait pas les causes des coûts, mais l’ensemble de l’entreprise comme génératrice des coûts.
Une clé de répartition est vérifiable si des tiers compétents sont à même d’identifier, sans recourir à d’autres informations, comment et sur quelle base cette clé a été conçue. La vérifiabilité implique aussi la preuve des coûts, c’est-à-dire la preuve des valeurs sous-jacentes à la clé de répartition. Les heures de travail consignées ou le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules peuvent servir de justificatifs.
Une clé de répartition peut donc être pertinente sans pour autant être vérifiable si les valeurs qui la sous-tendent ne sont pas prouvées. Tel serait le cas d’une clé de répartition basée sur la charge de travail estimée en l’absence de tout compte-rendu des heures effectuées.
La clé de répartition devrait être définie par écrit et consignée, par exemple, dans un manuel de comptabilité analytique ou dans un autre document analogue.
Le principe de constance signifie que la clé de répartition doit être apte à permettre une répartition des coûts respectueuse du principe de causalité pendant de nombreux exercices.
L’ElCom s’est exprimée, dans plusieurs décisions, sur le thème de la répartition des coûts (cf. décision de l’ElCom du 17 novembre 2016, 211-00016, ou lettre de clôture de l’ElCom du 21 novembre 2017, 212-00233).
3.2.9.3 Facturation interne
Les prix facturés en interne doivent être strictement basés sur les coûts et ne pas contenir de composante déjà rémunérée au titre des coûts de capital et d’exploitation régulatoires.
En font partie toutes les sortes de participation au bénéfice qui sont facturées au réseau ou les coûts qui entraîneraient une double facturation, tels que :
- les parts d’amortissement d’installations comprises dans les immobilisations régulatoires où elles sont donc déjà amorties ;
- les parts de bénéfice liées à des prestations au sein de l’entreprise ;
- marges bénéficiaires pour la vente d’énergie du secteur de l’énergie au réseau ;
- intérêts théoriques sur fonds propres (couverts par le WACC).
Les secteurs réglementés ne doivent pas être défavorisés lors de la facturation de prestations. Cela signifie que les prestations fournies par le réseau à d’autres secteurs d’activité doivent être rémunérées de manière adéquate. Inversement, les prestations fournies au réseau par d’autres secteurs d’activité doivent posséder une valeur et être basées sur les coûts. En d’autres termes, les prestations fournies au réseau doivent l’être dans un délai raisonnable et parvenir aux résultats convenus. En outre, les coûts des prestations fournies et facturées doivent être déduits des coûts du réseau (et reportés à la position « Autres résultats d’exploitation », cf. point 3.2.21.2 ci-dessous). Les bases de la facturation interne de prestations fournies avec les ressources du réseau à d’autres secteurs et aux tiers doivent être documentées et vérifiables. La facturation de prestations au réseau par d’autres secteurs doit aussi être documentée. Cette documentation comprend notamment les prix facturés, les buts de la fourniture des services ainsi que les décomptes et rapports correspondants.
Les principes de facturation interne doivent être appliqués avec constance. Les prix de facturation, les éléments de coûts sous-jacents et la méthodologie doivent être documentés, par exemple dans un manuel de comptabilité ou dans des documents analogues.
De plus, l’ElCom observe d’un œil critique les structures d’entreprise qui sortent de l’ordinaire. De telles structures ne doivent pas servir à contourner les règles de la LApEl concernant la rémunération de l’utilisation du réseau.
3.2.9.4 Utilisation d’infrastructures (de réserve) par des tiers
Le terme de « tiers » regroupe tous les domaines étrangers au réseau ou les tiers externes. Il n’est pas permis de mettre gratuitement à la disposition de tiers l’utilisation des infrastructures du secteur monopolistique, même en invoquant que « l’infrastructure existe déjà » ou que « les salaires du personnel requis pour l’exploitation sont déjà payés ». Si des infrastructures du secteur monopolistique sont utilisées par d’autres domaines, avec ou sans autres ressources, cette utilisation doit être indemnisée aux conditions du marché (conformément au principe de pleine concurrence) et cette indemnisation doit être déduite des coûts du réseau (report à la position « Autres résultats d’exploitation », cf. point 3.2.21.2 ci-dessous).
Voici un exemple tiré de la pratique :
Lors de la réalisation de tracés, il est fréquent que des tubes de réserve soient posés afin de permettre des extensions et des renforcements ultérieurs du réseau sans coût important. Les surcoûts causés par les tubes de réserve supplémentaires sont pratiquement négligeables. Afin d’éviter un doublement de galeries de câbles, les tubes de réserve non nécessaires, ou qui ne sont que partiellement occupés, sont utilisés pour le passage de câbles en fibre optique. Le réseau doit être indemnisé pour cette utilisation. Des intervenants ont parfois fait valoir que la place nécessaire aux câbles en fibre optique ne coûte rien. De plus, dans certains endroits, les câbles en fibre optique sont utilisés non seulement en dehors du domaine de l’électricité (transmission de données, Internet, etc.), mais également pour communiquer avec les systèmes de mesure intelligents. Certains gestionnaires de réseau ont donc imputé, à tort, la totalité de l’infrastructure en fibres optiques aux coûts du réseau.
Comme les capacités des câbles en fibre optique excèdent largement les quantités de données à transmettre pour les solutions de comptage intelligent et que le développement d’un réseau en fibre optique sur l’ensemble du territoire (des fibres optiques reliant chaque bâtiment) ne semble pas nécessaire pour transmettre des quantités de données assez faibles, les coûts d’un réseau en fibre optique ne peuvent être imputés que dans une mesure limitée au secteur réseau.
L’art. 10, al. 1, LApEl est déterminant pour la répartition des coûts des câbles en fibre optique posés dans les tracés. Il stipule que les subventions croisées entre l’exploitation du réseau et les autres secteurs d’activité sont interdites. Il n’est donc pas possible de proposer des prestations du réseau de fibre optique à un prix plus avantageux au détriment de l’approvisionnement en électricité. Conformément à l’art. 7, al. 5, OApEl, il faut définir et appliquer des clés de répartition pertinentes pour assurer une imputation des coûts respectant le principe de causalité. Par exemple, l’ElCom considère qu’il est pertinent de répartir ou de ventiler les coûts en fonction de la séparation transversale des tracés, comme le propose l’AES (cf. communications de l’ElCom du 8 juillet 2011 et du 4 octobre 2010).
3.2.9.5 Marketing, publicité et sponsoring
Les coûts de marketing et de sponsoring ne sont pas nécessaires à l’exploitation d’un réseau sûr, performant et efficace (art. 15, al. 1, LApEl). C’est pourquoi les coûts liés au parrainage de manifestations sportives, culturelles ou autres ne sont pas acceptés comme coûts d’exploitation. Il en va de même des coûts publicitaires liés à l’acquisition de clients, à l’introduction de produits ou à des mesures entrepreneuriales visant à promouvoir les énergies renouvelables.
3.2.9.6 Charges d’intérêts sur les fonds étrangers
Les charges d’intérêts sur les fonds étrangers n’entrent pas dans les coûts d’exploitation. Pour calculer les coûts du capital imputable, les valeurs résiduelles des immobilisations sont rémunérées au taux du coût moyen pondéré du capital (WACC). Le WACC contient déjà les intérêts sur les fonds étrangers en faveur des propriétaires du réseau indépendamment du fait qu’ils constituent ou non une charge effective (ANDRE SPIELMANN dans : Kommentar zum Energierecht, Brigitta Kratz / Michael Merker / Renato Tami / Stefan Rechsteiner / Kathrin Föhse [éd.], tome I, Berne 2016, art. 15 LApEl, ch. marg. 71).
3.2.9.7 Coûts d’exploitation et de capital des systèmes de mesure
Notons que les coûts théoriques des systèmes de commande et de réglage intelligents (appelés aussi installations de commande à distance et de commande centralisées) doivent être présentés pour le calcul des tarifs aux positions 530 (cf. art. 7, al. 3, let. m, OApEl). Il n’est donc plus permis de les saisir à la position 200. Si, exceptionnellement, il n’était pas possible d’attribuer précisément des coûts imputables, quelle qu’en soit leur nature, ces coûts devraient figurer à la position 200.3.
Les coûts résultant d’une mise en œuvre efficace et basée sur les risques des mesures de cybersécurité peuvent être imputés. Pour ce faire, le guide PIC de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) constitue une bonne référence. Pour les coûts imputables, il convient de se référer au présent guide d’utilisation du fichier de comptabilité analytique et, à titre subsidiaire, au schéma de calcul des coûts pour les gestionnaires de réseau de distribution suisses (SCCD) de l’Association des entreprises électriques suisses. La structure et les exemples de la communication de l’ElCom « Imputation des coûts de la cybersécurité » du 28 septembre 2022 (disponible à l’adresse www.elcom.admin.ch > Documentation > Communications) doivent aider à saisir ces coûts de manière appropriée. En règle générale, les coûts liés à la protection des technologies opérationnelles (OT)[1] devraient être indiqués sous les positions 200 et 500 et les coûts liés à la protection de l’informatique (IT)[2] sous la position 600 de la comptabilité analytique. En ce qui concerne la durée d’amortissement du matériel et des logiciels, le tableau 1 du SCCD s’applique. L’ElCom se réserve le droit de vérifier, dans le cadre de sa surveillance, la mise en œuvre efficace des mesures de protection et des coûts. La comptabilité financière devrait donc être conçue de manière à ce que les coûts des mesures de protection contre les cyberincidents puissent être présentés le plus facilement possible. Il faut tenir compte du fait que seuls les coûts concernant le réseau peuvent être imputés (art. 15 LApEl en relation avec l’art. 10 LApEl). Les coûts de la protection des systèmes TIC d’autres secteurs (p. ex. énergie, télécommunications, gaz, etc.) doivent être séparés directement ou par le biais d’une clé de répartition appropriée (art. 7, al. 5, OApEl) et imputés aux secteurs correspondants (cf. chapitre 2, SCCD).
[1] Par technologies opérationnelles (Operational Technology, OT), on entend les technologies qui sont directement nécessaires à la mise à disposition ou à la fourniture d’électricité (p. ex. SCADA, PIA, accès à distance aux installations dans les sous-stations, télécommande centralisée, gestion des données énergétiques (EDM), compteurs intelligents).
[2] Par technologies de l’information (IT), on entend les technologies de traitement des données qui ne sont pas directement liées à la fourniture d’électricité (p. ex. gestion des données clients, gestion des données du personnel, applications bureautiques).
3.2.10 Exploitation des réseaux (position 200.1a)
Cette position regroupe tous les coûts nécessaires à l’exploitation d’une infrastructure de réseau efficace et sûre. En font notamment partie les coûts d’exploitation et d’entretien des réseaux (personnel, matériel, prestations de tiers, etc.), mais aussi les activités telles que la planification du réseau, la gestion du système d’information géographique (SIG), l’actualisation du cadastre des lignes, les travaux liés à la gestion d’actifs, le contrôle du réseau ou le service de permanence. Cette position comprend aussi les coûts liés aux services-système du réseau de distribution et aux écarts par rapport à la planification. On y trouve en outre les coûts de l’assurance responsabilité civile des entreprises, les coûts d’établissement des documentations et des processus, les coûts de gestion de la qualité, les coûts de formation du personnel ou les coûts liés à la sécurité au travail.
3.2.11 Entretien des réseaux (position 200.2)
Les coûts d’entretien comprennent notamment les coûts d’entretien des installations tels que le remplacement ou le remplacement partiel de petites pièces, la protection contre la corrosion, etc. Cette position comprend aussi les activités non admises dans la rubrique des immobilisations régulatoires comme les coûts de démolition ou les coûts de solutions provisoires et les coûts d’entretien généraux (cf. points 2.2.3 Coûts de démolition, de démantèlement ou de solution provisoire et 2.2.5 Coûts d’entretien et investissements de remplacement).
On peut aussi déclarer dans cette position les prestations pour l’achat de matériel et de services (identification des besoins en matériel et en services ainsi que des fournisseurs potentiels, analyse du marché, sélection des offreurs et négociations contractuelles, exécution des mandats d’achat), pour les stocks (coûts de livraison de matériel ou de gestion des stocks, contrôle de la qualité du matériel en stock, dépréciation du matériel en stock), pour l’entretien ou, dans le cadre des étapes de planification, pour la construction d’une installation (cf. point 2.1.3).
Les positions 200.1a « Exploitation des réseaux » et 200.2 « Entretien des réseaux » doivent être présentées séparément. Si elles ne sont pas séparées, il convient de l’indiquer dans les remarques.
3.2.12 OSTRAL (position 200.1b)
En cas de pénurie d’électricité, le Conseil fédéral peut ordonner des mesures de gestion de l’approvisionnement économique du pays (AEP). L’AEP a chargé l’Association des entreprises électriques suisses (AES) des préparatifs nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures. Dans cette optique, l’AES a créé l’Organisation pour l’approvisionnement en électricité en cas de crise (OSTRAL). On saisira dans cette position les coûts qui surviendront en raison des consignes de l’OSTRAL destinées à préparer et à exécuter les mesures de gestion de l’AEP (art. 4, al. 2, de l’ordonnance sur l’organisation du secteur de l’électricité pour garantir l’approvisionnement économique du pays (OOSE ; RS 531.35). Conformément à l’art. 4, al. 3, OOSE (version du 1er juin 2022), l’ElCom est chargée de surveiller ces coûts.
À partir des tarifs 2025, les coûts directement occasionnés aux gestionnaires de réseau, aux producteurs et aux gestionnaires d’installations de stockage par des mesures nécessaires au maintien de l’approvisionnement en électricité en application de la loi sur l’approvisionnement du pays sont considérés comme des coûts d’exploitation imputables au réseau de transport (art. 15a, al. 1, let. b, LApEl ; art. 4a, al. 1, OOSE [version du 1er janvier 2025]). Les coûts en question doivent donc être facturés à Swissgrid.
3.2.13 Autres coûts (position 200.3)
Les coûts ne pouvant exceptionnellement pas être attribués précisément doivent être imputés à la position 200.3, quelle que soit leur nature.
3.2.14 Pertes actives des réseaux propres (position 200.4)
Dans cette position, seules doivent être saisies les pertes actives du propre réseau (cf. point 3.1.2 ci-dessus).
En vertu de l’art. 15, al. 1, let. a, OApEl, Swissgrid facture individuellement aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport les coûts de compensation des pertes et de fourniture d’énergie réactive qu’ils ont occasionnés. Ces coûts doivent être présentés à la position 300 (cf. point 3.2.15 ci-dessous).
3.2.15 Coûts des réseaux amont (position 300)
Les coûts des niveaux de réseau amont sont a priori repris de l’onglet « Généralités » par le biais de formules. Si des valeurs différentes ont été utilisées pour votre calcul, veuillez remplacer les formules par la valeur effective.
Il y a lieu d’indiquer les coûts nets, c’est-à-dire déduction faite des éventuels rabais. Les paiements compensatoires reçus en situation de superposition (« pancaking ») sont également à déduire.
Les coûts doivent être enregistrés dans les colonnes des niveaux de réseau auxquels vous êtes raccordés à votre fournisseur amont. Si votre niveau de réseau le plus élevé est par exemple le NR3, les coûts du fournisseur amont doivent être saisis au NR2, sauf dans les cas de superposition (« pancaking »), où les coûts devraient être saisis au NR3.
3.2.16 Coûts des services-système et de la réserve d’électricité (position 400)
Les services-système (PSS) et la réserve d’électricité sont les services nécessaires à l’exploitation stable et sûre du réseau dans l’approvisionnement en électricité. Il s’agit de services auxiliaires que les gestionnaires de réseau d’électricité sont tenus de fournir en plus du transport et de la distribution d’énergie électrique.
Les coûts facturés par Swissgrid pour les services-système fournis et pour la réserve d’électricité sont saisis à la position 400. Les coûts des services-système du réseau de distribution doivent être imputés à la position 200.1 (cf. point 3.2.10 ci-dessus).
Veuillez utiliser exclusivement cette position pour les coûts facturés par Swissgrid et ne les indiquez pas en utilisant le niveau de réseau 1.
3.2.17 Coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage (position 500)
3.2.17.1 Généralités
La comptabilité analytique doit faire apparaître séparément toutes les positions nécessaires au calcul des coûts imputables, dont les coûts de mesure et d’information, les coûts des systèmes de mesure intelligents et les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents, indemnités incluses (art. 7, al. 3, let. f, fbis et m, OApEl).
Conformément à l’ancien art. 13a, let. a, OApEl, tous les coûts de capital et d’exploitation des systèmes de mesure visés dans cette ordonnance sont imputables. Cela s’applique à tous les systèmes de mesure qui sont mis en service pendant le champ d’application temporel de la nouvelle ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, c.-à-d. à partir du 1er janvier 2018. Ainsi, les coûts liés aux mesures de la courbe de charge (qui ne répondent pas encore aux exigences des anciens art. 8a ss. OApEl) sont imputables en tant que coûts du réseau (art. 31l, al. 3, OApEl).
Avec l’entrée en vigueur de la stratégie Réseaux électriques le 1er juin 2019, l’art. 31e, al. 4, OApEl a été abrogé. À partir de cette date, les coûts des dispositifs de mesure de la courbe de charge déjà utilisés avant le 1er janvier 2018 sont également imputables. Les coûts déjà imputables au réseau depuis le 1er janvier 2018 sont les coûts des systèmes de mesure installés chez les producteurs à partir de cette date (art. 15, al. 1, LApEl ; anc. art. 13a, let. a, OApEl).
Les coûts liés à une mise en œuvre efficace et basée sur les risques des mesures de cybersécurité sont imputables. Les coûts liés à la protection des technologies opérationnelles (OT) peuvent notamment être saisis aux positions 510.4 et 520.4 (explications plus détaillées au point 3.2.9.7).
3.2.17.2 Coûts des systèmes de mesure intelligents (position 510)
Des tiers peuvent participer, avec l’accord du gestionnaire de réseau, à la fourniture de prestations dans le cadre du système de mesure et d’information (cf. anc. art. 8, al. 2, OApEl).
Pour mettre en œuvre ce qui précède (art. 7, al. 3, let. f et fbis, et anc. art. 8, al. 2, OApEl), le gestionnaire de réseau de distribution doit ainsi détailler les coûts, en particulier en ce qui concerne les prestations de mesure.
L’art. 17a LApEl, précisé par les anciens art. 8a et 8b OApEl, instaure un nouveau standard minimum en matière de système de mesure intelligent. 80 % des installations de mesure d’une zone de desserte devront répondre à ce standard dans les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2017 (art. 31e, al. 1, OApEl), soit le 31 décembre 2027.
Les coûts des systèmes de mesure intelligents qui satisfont aux standards fixés à l’art. 17a LApEl en lien avec les anciens art. 8a et 8b OApEl, doivent être saisis à la position 510 « Coûts des systèmes de mesure intelligents ». Les coûts des systèmes de mesure qui, selon l’art. 31l, al. 1 et 2, OApEl, peuvent être attribués à ces 80 %, sont également imputés à la position 510 « Coûts des systèmes de mesure intelligents ». Ces dispositions divergent du SCCD-CH, qui attribue ces coûts à la position 520 « Coûts des autres systèmes de mesure et d’information » (cf. point 2.2.8).
3.2.17.3 Coûts des autres instruments de mesure et d’information
Par contre, toutes les installations de mesure qui ne remplissent pas les standards fixés à l’art. 17a LApEl, en lien avec les anciens art. 8a et 8b OApEl, et qui ne peuvent pas être affectées aux 80 % selon l’art. 31l, al. 1 et 2, OApEl, mais qui sont toujours en fonction, doivent quant à elles être enregistrées à la position 520 « Coûts des autres systèmes de mesure et d’information ».
3.2.17.4 Amortissements théoriques pour les systèmes de mesure des deux types (positions 510.1 et 520.1)
Les amortissements des systèmes de mesure compris dans les immobilisations régulatoires doivent être présentés sous cette position. Une double prise en compte des coûts des systèmes de mesure, dans les immobilisations régulatoires du réseau et dans les amortissements déclarés à la position 100.1 d’une part, et dans les coûts de mesure d’autre part, n’est pas autorisée. Les coûts des installations utilisées partiellement, comme les systèmes de gestion des données énergétiques, doivent être imputés en proportion correspondante aux coûts de mesure et au réseau. L’ElCom se réserve le droit d’effectuer des contrôles par échantillonnage à ce sujet.
Voici quelques exemples d’installations qu’il est permis d’intégrer dans les immobilisations régulatoires et qui, par conséquent, peuvent être amorties et rémunérées : compteurs, éventuels transformateurs, bornes de contrôle, unités de communication, appareil de saisie mobile des données, équipement de relevé à distance des compteurs, etc.
3.2.17.5 Intérêts théoriques pour les systèmes de mesure des deux types (positions 510.2 et 520.2)
Les intérêts théoriques des systèmes de mesure compris dans les immobilisations régulatoires doivent être présentés sous cette position. Une double prise en compte des coûts des systèmes de mesure, dans les immobilisations régulatoires du réseau et dans les intérêts déclarés à la position 100.2 d’une part, et dans les coûts de mesure d’autre part, n’est pas autorisée.
Comme les systèmes de mesure entrent dans les coûts du réseau et qu’ils font donc partie du patrimoine du réseau nécessaire à son exploitation, on recourt au même taux de WACC que pour le calcul des intérêts théoriques du réseau.
3.2.17.6 Prestations de mesure pour les systèmes de mesure des deux types (positions 510.3 et 520.3)
Pour les systèmes de mesure intelligents, il faut saisir la part respective des coûts suivants (coûts propres ou coûts de tiers) :
- coûts d’exploitation du dispositif de relevé à distance des compteurs (RDC) et de transmission des données ;
- coûts d’exploitation de la gestion des données énergétiques (part des coûts du réseau EDM) pour la mise à disposition, l’archivage et la fourniture des données ;
- coûts d’exploitation de la gestion des données énergétiques (part des coûts du réseau EDM) pour les processus de changement, les contrôles de plausibilité et l’établissement des valeurs de substitution.
3.2.17.7 Autres coûts pour les systèmes de mesure des deux types (positions 510.4 et 520.4)
Voici quelques exemples de coûts saisis à ces positions :
- logistique liée aux compteurs (achat, stockage, installation, étalonnage, contrôle périodique des compteurs, entretien, gestion du stock, etc.), gestion des compteurs et des stations de mesure (gestion des données de base) ;
- coûts d’exploitation pour les relevés et la transmission des données (p. ex. saisie mobile des données (SMD) ;
- coûts de communication ;
- coûts proportionnels pour les locaux, l’informatique et les véhicules, etc.
3.2.17.8 Coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents (position 530)
Si un consommateur final, un producteur ou un gestionnaire d’installations de stockage consent à ce qu’un système de commande et de réglage visant à assurer une exploitation sûre, performante et efficace du réseau (flexibilité) soit utilisé, il doit notamment convenir des modalités de rétribution de l’utilisation du système avec le gestionnaire de réseau (art. 8c, al. 1, let. c, OApEl).
Cette rétribution doit se fonder sur des critères objectifs et ne doit pas être discriminatoire (art. 8c, al. 2, OApEl). Les taux de rétribution doivent être publiés (art. 8c, al. 3, OApEl en lien avec les art. 12, al. 1, LApEl et l’anc. art. 10 OApEl). La comptabilité analytique doit faire apparaître séparément toutes les positions nécessaires au calcul des coûts imputables, en particulier les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents, indemnités incluses (art. 7, al. 3, let. m, OApEl). L’indemnité dont il est question ici est la rétribution dont le gestionnaire de réseau s’acquitte en faveur du consommateur final, du producteur ou du gestionnaire d’installations de stockage pour sa flexibilité (art. 8c OApEl).
Pour mettre en œuvre ce qui précède, le gestionnaire de réseau de distribution doit détailler les coûts générés par les systèmes de commande et de réglage au sens de l’art. 8c OApEl. Les données comptables correspondantes doivent être enregistrées à la position 530 « Coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents ». Cette position doit contenir, outre l’ensemble des installations qui entrent dans la description des systèmes de commande et de réglage intelligents, les installations classiques de commande centralisées (cf. Explications sur la révision partielle de l’OApEl de novembre 2017, p. 10 ss ; art. 31 s. OApEl).
Si un gestionnaire de réseau offre une utilisation flexible du réseau au consommateur final, au producteur ou au gestionnaire d’installations de de stockage au moyen de systèmes de commande et de réglage intelligents, il a non seulement l’obligation de publier la rétribution prévue dans sa fiche tarifaire (art. 8c, al. 3, OApEl en lien avec les art. 12, al. 1, LApEl et l’anc. art. 10 OApEl), mais également d’enregistrer les montants ainsi versés dans la comptabilité analytique à la position 530.3 « Indemnités au consommateur final et au producteur ».